Ce sont les Fêtes, vos commandes seront expédiées à partir du 02/01/2024. Passez de bonnes fêtes !
Menu
Menu

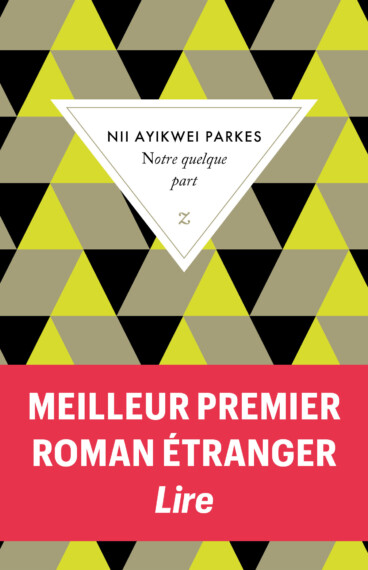 Notre quelque part« NOTRE QUELQUE PART est certainement l’un des plus beaux romans parus ces dernières années pour dire avec un étonnant mélange, quasiment parfait, d’humour et de sérieux le choc de la modernité et de la tradition, de l’avidité corrompue et du respect ancestral, du fantastique doux des contes anciens et de la rationalité techno-économique du contemporain, au sein des pays d’Afrique de l’Ouest. Usant de la découverte « accidentelle » de restes humains dans une case villageoise du pays ashanti, Nii Ayikwei Parkes déploie une fabuleuse galerie de personnages (chasseur traditionnel sage et malicieux, jeune légiste diplômé au Royaume-Uni, policier de haut rang occidentalisé et formidablement ambitieux, gardiens de la paix loin de se limiter à la brutale épaisseur qu’ils véhiculent initialement, tenancière de maquis ayant plus d’un tour dans son sac,…) acquérant très rapidement leur épaisseur propre pour nous enchanter dans un récit à tiroirs jusqu’à l’ambiguë révélation finale, où il ne sera plus du tout question d’un éventuel McGuffin, mais au contraire d’une possible magie centrale et d’une ferveur dans la synthèse présente du passé et de l’avenir. L’auteur utilise tout au long une merveilleuse langue contrastée et poétique (la poésie représente d’ailleurs la grande majorité de son travail en anglais) : dans la version originale, il orchestre suivant les lieux, les moments et les intentions des locuteurs l’anglais « classique », les expressions directement rendues de la langue twi, comme le savant mélange de l’anglais vernaculaire et de la structure twi – ce pour quoi il faut souligner le superbe travail de la traductrice béninoise Sika Fakambi, qui parvient à reproduire savoureusement le mécanisme en « collant » à ses équivalents en français du Bénin ou du Togo, utilisant le fon en lieu et place du twi, pour obtenir un bel effet de réalisme aux sonorités familières à tout voyageur en ces pays, ou à tout lecteur de Florent Couao-Zotti, par exemple. Une très belle révélation, qui devrait inciter toujours davantage de lectrices et de lecteurs à se plonger dans la troublante beauté des grands textes contemporains d’Afrique. » Librairie Charybde — Paris
Notre quelque part« NOTRE QUELQUE PART est certainement l’un des plus beaux romans parus ces dernières années pour dire avec un étonnant mélange, quasiment parfait, d’humour et de sérieux le choc de la modernité et de la tradition, de l’avidité corrompue et du respect ancestral, du fantastique doux des contes anciens et de la rationalité techno-économique du contemporain, au sein des pays d’Afrique de l’Ouest. Usant de la découverte « accidentelle » de restes humains dans une case villageoise du pays ashanti, Nii Ayikwei Parkes déploie une fabuleuse galerie de personnages (chasseur traditionnel sage et malicieux, jeune légiste diplômé au Royaume-Uni, policier de haut rang occidentalisé et formidablement ambitieux, gardiens de la paix loin de se limiter à la brutale épaisseur qu’ils véhiculent initialement, tenancière de maquis ayant plus d’un tour dans son sac,…) acquérant très rapidement leur épaisseur propre pour nous enchanter dans un récit à tiroirs jusqu’à l’ambiguë révélation finale, où il ne sera plus du tout question d’un éventuel McGuffin, mais au contraire d’une possible magie centrale et d’une ferveur dans la synthèse présente du passé et de l’avenir. L’auteur utilise tout au long une merveilleuse langue contrastée et poétique (la poésie représente d’ailleurs la grande majorité de son travail en anglais) : dans la version originale, il orchestre suivant les lieux, les moments et les intentions des locuteurs l’anglais « classique », les expressions directement rendues de la langue twi, comme le savant mélange de l’anglais vernaculaire et de la structure twi – ce pour quoi il faut souligner le superbe travail de la traductrice béninoise Sika Fakambi, qui parvient à reproduire savoureusement le mécanisme en « collant » à ses équivalents en français du Bénin ou du Togo, utilisant le fon en lieu et place du twi, pour obtenir un bel effet de réalisme aux sonorités familières à tout voyageur en ces pays, ou à tout lecteur de Florent Couao-Zotti, par exemple. Une très belle révélation, qui devrait inciter toujours davantage de lectrices et de lecteurs à se plonger dans la troublante beauté des grands textes contemporains d’Afrique. » Librairie Charybde — Paris Snapshots — Nouvelles voix du Caine Prize« Révélant une réalité terrible, à la lisière des cauchemars et du fantastique, « Hunter Emmanuel » de la Sud-Africaine Constance Myburgh suit l’enquête non officielle d’un ancien policier embauché comme bûcheron qui découvre une jambe de femme au sommet d’un arbre, et qui ne ressortira pas indemne de cette enquête qui va le rapprocher dangereusement de l’horreur indicible, tandis que « Jours de baston » de l’écrivain de Sierra Leone Olufemi Terry évoque les combats de rue des enfants, rappelant le très impressionnant « Corps à l’écart » de Elisabetta Bucciarelli.
Snapshots — Nouvelles voix du Caine Prize« Révélant une réalité terrible, à la lisière des cauchemars et du fantastique, « Hunter Emmanuel » de la Sud-Africaine Constance Myburgh suit l’enquête non officielle d’un ancien policier embauché comme bûcheron qui découvre une jambe de femme au sommet d’un arbre, et qui ne ressortira pas indemne de cette enquête qui va le rapprocher dangereusement de l’horreur indicible, tandis que « Jours de baston » de l’écrivain de Sierra Leone Olufemi Terry évoque les combats de rue des enfants, rappelant le très impressionnant « Corps à l’écart » de Elisabetta Bucciarelli.
Plus porteurs d’espoir ou ironiques, tout en évoquant les difficultés de l’exil ; « America » de la Nigériane Chinelo Okparanta dévoile peu à peu, au cours du trajet en bus de Port Harcourt vers Lagos, l’histoire intime et la persévérance d’une jeune enseignante qui rêve d’émigrer en Amérique, ainsi que la dureté de son pays et ses tabous ; et « Miracle », de l’américain d’origine nigériane Tope Folarin, raconté par la voix d’un enfant de la diaspora, qui se déroule au Texas, au cours d’une messe où les fidèles de la communauté nigériane sont rassemblés pour assister à la harangue et aux miracles d’un pasteur aveugle. La croyance dans les miracles religieux est ici la prospérité accomplie avec l’exil américain, miracle qui, comme on s’en doute, ne s’accomplit pas toujours.
Mes deux nouvelles préférées dans ce recueil : La Zimbabwéenne NoViolet Bulawayo crée un choc bouleversant dans SNAPSHOTS, avec la trajectoire dramatique d’une petite fille des quartiers pauvres de Harare, vendant des œufs dans la rue à l’adolescence pour survivre, une peinture vivide et indélébile de la misère et du sort des femmes, sur fond de crise économique et d’inflation galopante, et de tentatives d’émigration vers une Afrique du Sud incertaine et dangereuse.
Et enfin, concluant cet opus, « La république de Bombay » du Nigérian Rotimi Babatunde forme une critique acérée du colonialisme sur un mode tragicomique, au travers de l’histoire du Sergent de couleur dit Bombay, enrôlé pour combattre Hitler et les japonais pendant la seconde guerre mondiale sur un front oublié en Asie du Sud-Est, et qui, ayant découvert au front une nouvelle vision du monde – les stéréotypes envers les africains et la vulnérabilité des Blancs qui se présentaient comme invincibles -, proclame à son retour au pays un état indépendant dans une ancienne prison dominant la ville. » Librairie Charybde — Paris
 Les Nuits de laitue« Méditation étonnamment légère sur la perte d’un être cher, et intrigue policière inattendue. Excentriques voisins d’un quartier pourtant très banal, les personnages des Nuits de laitue semblent toujours en mouvement, y compris Otto, le personnage central insomniaque et antisocial, accablé depuis le décès imprévisible de son épouse Ada. Formant une merveilleuse galerie de portraits, ces personnages pourtant banals semblent tous affublés de manies curieuses, tel Aníbal le facteur dilettante, qui distribue les courriers à tort et à travers, Nico l’assistant pharmacien passionné des notices de médicaments et de leurs effrayants effets secondaires potentiels, Iolanda la mystique qui épouse toutes les croyances ou encore Teresa et ses trois chiens fous furieux. L’unique M. Taniguchi, “centenaire taciturne, sobre et consciencieux”, malheureusement atteint de la maladie d’Alzheimer est le “clou” de cette galerie de portraits, personnage inspiré à l’auteur par Hiroo Onoda, ce soldat japonais qui ne crut jamais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et se battit jusqu’en 1974 dans une île des Philippines, avant de finalement renoncer sur ordre de son commandant, et d’émigrer pour finir ses jours au Brésil. Tout en se remémorant de manière erratique de fragments heureux de sa vie conjugale, avec une Ada virevoltante et indispensable, Otto lutte pour faire face aux situations les plus élémentaires depuis sa disparition, et, sortant de sa coquille, recueille des indices épars de la vie de ses voisins, qui lui parvenaient jusque-là par le filtre de sa femme. Ces bribes de conversation entendues dans la rue ou à travers les cloisons trop minces le perturbent, évoquant ce qu’ils appellent “l’incident”. Cet homme taciturne qui adore “les histoires de meurtres embrouillées, les films noirs et les polars sanglants” en vient ainsi à penser qu’on lui cache quelque chose. Ce premier roman “en solo” de Vanessa Barbara forme un récit très attachant, méditation mélancolique sur la perte et la solitude sous une forme pleine de légèreté et d’humour, comme un reflet du tempérament de feu follet d’Ada, rappelant la tonalité du Margherita Dolcevita de Stefano Benni, et qui prend au fil des pages un tour inattendu d’intrigue policière. » Librairie Charybde — Paris
Les Nuits de laitue« Méditation étonnamment légère sur la perte d’un être cher, et intrigue policière inattendue. Excentriques voisins d’un quartier pourtant très banal, les personnages des Nuits de laitue semblent toujours en mouvement, y compris Otto, le personnage central insomniaque et antisocial, accablé depuis le décès imprévisible de son épouse Ada. Formant une merveilleuse galerie de portraits, ces personnages pourtant banals semblent tous affublés de manies curieuses, tel Aníbal le facteur dilettante, qui distribue les courriers à tort et à travers, Nico l’assistant pharmacien passionné des notices de médicaments et de leurs effrayants effets secondaires potentiels, Iolanda la mystique qui épouse toutes les croyances ou encore Teresa et ses trois chiens fous furieux. L’unique M. Taniguchi, “centenaire taciturne, sobre et consciencieux”, malheureusement atteint de la maladie d’Alzheimer est le “clou” de cette galerie de portraits, personnage inspiré à l’auteur par Hiroo Onoda, ce soldat japonais qui ne crut jamais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et se battit jusqu’en 1974 dans une île des Philippines, avant de finalement renoncer sur ordre de son commandant, et d’émigrer pour finir ses jours au Brésil. Tout en se remémorant de manière erratique de fragments heureux de sa vie conjugale, avec une Ada virevoltante et indispensable, Otto lutte pour faire face aux situations les plus élémentaires depuis sa disparition, et, sortant de sa coquille, recueille des indices épars de la vie de ses voisins, qui lui parvenaient jusque-là par le filtre de sa femme. Ces bribes de conversation entendues dans la rue ou à travers les cloisons trop minces le perturbent, évoquant ce qu’ils appellent “l’incident”. Cet homme taciturne qui adore “les histoires de meurtres embrouillées, les films noirs et les polars sanglants” en vient ainsi à penser qu’on lui cache quelque chose. Ce premier roman “en solo” de Vanessa Barbara forme un récit très attachant, méditation mélancolique sur la perte et la solitude sous une forme pleine de légèreté et d’humour, comme un reflet du tempérament de feu follet d’Ada, rappelant la tonalité du Margherita Dolcevita de Stefano Benni, et qui prend au fil des pages un tour inattendu d’intrigue policière. » Librairie Charybde — Paris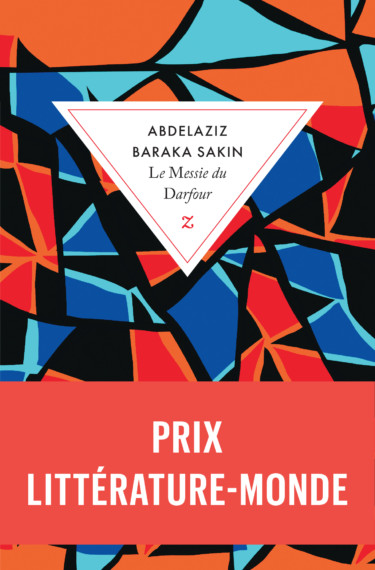 Le Messie du Darfour
Le Messie du Darfour« Si le nom propre « Darfour » a été abondamment repris et scandé par les grands médias français de toute obédience depuis une dizaine d’années, il faut reconnaître que la lectrice ou le lecteur, même doué(e)s d’une réelle curiosité, aura eu bien du mal à se mettre sous les yeux (quasiment depuis 1989, donc au moment de la « première » guerre du Darfour, mais bien avant la « grande » guerre civile, qui a débuté en 2003, avec le grand La navigation du faiseur de pluie de Jahmal Majoub, traduit chez nous en 1999) de la fiction solide en provenance directe du Soudan lui-même. Il y aurait donc là d’emblée une première bonne raison pour se précipiter sur ce Messie du Darfour, publié en 2012 (sous forme de pdf, comme presque tous ses autres romans en arabe), traduit en français en 2016 par Xavier Luffin chez Zulma, dont l’auteur, extrêmement populaire dans son pays natal, ainsi qu’en Égypte et en Syrie, a dû fuir la pression du régime soudanais, vers l’Autriche, en 2013. Une deuxième raison, sans doute la plus importante, est la magnifique écriture d’Abdelaziz Baraka Sakin, alliant un style incisif – tel que rendu par la traduction, en tout cas – et un jeu subtil entre registres littéraires qui donne toute sa puissance à cette fable contemporaine échevelée, scandée de malheurs et de malédictions, de rires et de farces. Pour nous faire partager les ambitions et les espoirs, les vengeances et les doutes de ses héroïnes et de ses héros, Abderahman l’orpheline, sa mère adoptive tante Kharifiyya, les enrôlés de force Shikiri Toto Kuwa et Ibrahim Khidir, le chef rebelle Charon, l’éleveur oncle Jumaa Sakin, et le curieux personnage qui se fera appeler, quasiment malgré lui, le Messie du Darfour, l’auteur use d’une narration résolument humoristique, travaillée au corps du tragique conflit qui oppose ici les musulmans arabes soutenus par le gouvernement aux musulmans non-arabes parmi lesquels la rébellion s’est développée, protestant contre le racisme du régime de Khartoum et contre les politiques d’accaparement subreptice des terres des agriculteurs sédentaires au profit des éleveurs nomades. Dans ce maelstrom de guérillas et de contre-guérillas, où les luttes religieuses ne peuvent même plus masquer vaguement (comme ce fut le cas lors de la guerre civile ayant conduit à l’indépendance du Sud-Soudan en 2011) les seuls conflits d’avidité et de rapine, la longue malédiction de l’esclavagisme arabe dont l’ombre portée demeure ici particulièrement forte (et que peu d’auteurs africains, même de nos jours, affrontent de face, comme le firent par exemple le Yambo Ouologuem du Devoir de violence en 1968 et l’Ahmadou Kourouma de Monné, outrages et défis en 1990), et la triste descendance des échecs coloniaux, britanniques en l’occurrence, c’est tout le miracle d’Abdelaziz Baraka Sakin que de nous offrir, parmi les tueries et les viols massifs qui composent l’ordinaire de cette guerre de purification ethnique, une singulière et – mais oui ! – joueuse histoire d’amitié et d’amour, de destinée et d’humour, d’absence de résignation et d’affirmation de conviction solide. » Hugues Robert, librairie Charybde — Paris
 Murambi, le livre des ossements« Quatre ans après le génocide rwandais, et alors que seuls ou presque des Occidentaux s’étaient penchés sur cette horreur, plusieurs écrivains africains organisèrent une résidence collective pour travailler sur une parole à ce propos. Le Sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur notamment du grand LES TAMBOURS DE LA MÉMOIRE (1991), publiait en 2000 son travail issu de ce rassemblement : MURAMBI, LE LIVRE DES OSSEMENTS.
Récit du retour d’un Rwandais exilé à Djibouti, découvrant, après le génocide, que son père fut l’un des pires bourreaux hutu - responsable notamment du massacre (authentique) de l’École Technique de Murambi, où plusieurs dizaines de milliers de Tutsi furent rassemblés pour être exterminés, et où se trouve aujourd’hui le principal mémorial du génocide.
Roman terrible, qui pose au fond les mêmes questions que Jean Hatzfeld dans sa trilogie rwandaise, sous un angle différent, avec une rage beaucoup plus forte, même si elle y est romanesque, et non journalistique - mais reposant néanmoins sur de nombreux témoignages recueillis sur place en 1998.
La postface, entièrement écrite à l’occasion de la réédition de 2011, est précieuse : « Parti au Rwanda "par devoir de mémoire", je n’ai voulu abandonner personne sur le bord de la route. J’avais découvert, chemin faisant, ceci qui m’a paru fondamental : si un génocide aussi spectaculaire que celui des Tutsi du Rwanda implique des masses hurlantes d’hommes et de femmes pris au piège d’une panique collective sans nom, chacun n’entend, dans ce formidable chambardement, que les battements de son cœur, dans une soudaine et affreuse proximité avec sa propre mort. Il fallait aussi dire cette solitude des êtres livrés à eux-mêmes, parfois bien plus effroyable, à y regarder de plus près, que la sanglante pagaille alentour. Si j’ai en définitive choisi l’histoire que l’on vient de lire, c’est parce que je dois une autre leçon, tout aussi essentielle, au Rwanda : le crime de génocide est commis par les pères mais il est expié par les fils... »
D’une très grande voix africaine, un récit essentiel dans la quête d’une compréhension de l’horreur... » Librairie Charybde — Paris
Murambi, le livre des ossements« Quatre ans après le génocide rwandais, et alors que seuls ou presque des Occidentaux s’étaient penchés sur cette horreur, plusieurs écrivains africains organisèrent une résidence collective pour travailler sur une parole à ce propos. Le Sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur notamment du grand LES TAMBOURS DE LA MÉMOIRE (1991), publiait en 2000 son travail issu de ce rassemblement : MURAMBI, LE LIVRE DES OSSEMENTS.
Récit du retour d’un Rwandais exilé à Djibouti, découvrant, après le génocide, que son père fut l’un des pires bourreaux hutu - responsable notamment du massacre (authentique) de l’École Technique de Murambi, où plusieurs dizaines de milliers de Tutsi furent rassemblés pour être exterminés, et où se trouve aujourd’hui le principal mémorial du génocide.
Roman terrible, qui pose au fond les mêmes questions que Jean Hatzfeld dans sa trilogie rwandaise, sous un angle différent, avec une rage beaucoup plus forte, même si elle y est romanesque, et non journalistique - mais reposant néanmoins sur de nombreux témoignages recueillis sur place en 1998.
La postface, entièrement écrite à l’occasion de la réédition de 2011, est précieuse : « Parti au Rwanda "par devoir de mémoire", je n’ai voulu abandonner personne sur le bord de la route. J’avais découvert, chemin faisant, ceci qui m’a paru fondamental : si un génocide aussi spectaculaire que celui des Tutsi du Rwanda implique des masses hurlantes d’hommes et de femmes pris au piège d’une panique collective sans nom, chacun n’entend, dans ce formidable chambardement, que les battements de son cœur, dans une soudaine et affreuse proximité avec sa propre mort. Il fallait aussi dire cette solitude des êtres livrés à eux-mêmes, parfois bien plus effroyable, à y regarder de plus près, que la sanglante pagaille alentour. Si j’ai en définitive choisi l’histoire que l’on vient de lire, c’est parce que je dois une autre leçon, tout aussi essentielle, au Rwanda : le crime de génocide est commis par les pères mais il est expié par les fils... »
D’une très grande voix africaine, un récit essentiel dans la quête d’une compréhension de l’horreur... » Librairie Charybde — Paris
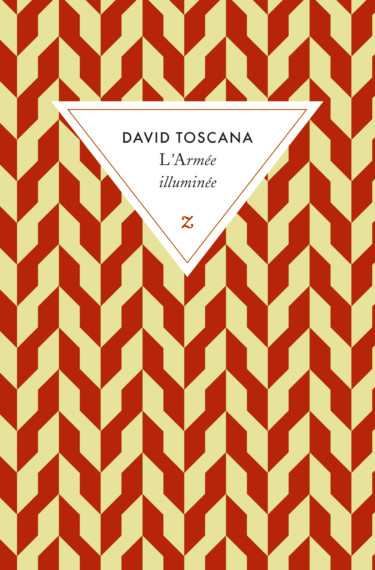 L’Armée illuminée«Paru en 2006 (en 2012 chez Zulma pour la belle traduction française de François-Michel Durazzo), le septième roman du Mexicain David Toscana est un étrange régal.
L’Armée illuminée«Paru en 2006 (en 2012 chez Zulma pour la belle traduction française de François-Michel Durazzo), le septième roman du Mexicain David Toscana est un étrange régal. Le Jardin dans l’île
Le Jardin dans l’île
« On trouve de tout dans ce petit recueil qu’est Le Jardin dans l’île. On y tombe amoureux dans des circonstances pour le moins particulières (« La Nuit des voltigeurs », « Le Jardin dans l’île »). Les hommes y sont fréquemment brisés par la vie mais retrouvent, au gré des circonstances, un peu de leur superbe (« Figure humaine », « L’enclos »). Les femmes y sont magnifiques, parfois mystérieuses, le plus souvent aimantes et maternelles (« Figure humaine », « Le Jardin dans l’île »). Et puis, au gré des circonstances, le lecteur peut y faire la connaissance d’un mystérieux courtier capable de dénicher l’objet de vos rêves (« Le courtier Delaunay ») ou louer une propriété pour le moins… particulière (« L’inhabitable »). La nostalgie y a souvent sa place, qu’elle se réfugie dans le bouquet d’un vin (« Château Naguère ») ou des souvenirs d’enfance heureusement fantasmés (« L’enclos »), même si elle est souvent contrebalancée par un humour tranquille, dérapant parfois dans l’absurde (« L’importun »). L’élégance et la classe de l’écriture de Georges-Olivier Châteaureynaud s’y déploient en toute évidence, son impeccable sens du rythme et de l’atmosphère y font merveille pour graver cette collection de miniatures dans l’esprit du lecteur. Et, comme pour parachever l’ensemble, l’auteur s’y permet le luxe d’une dernière novella qui n’a rien à envier aux meilleures épopées de fantasy, commençant comme une fresque guerrière et se refermant en huis-clos dramatique au sein d’une forteresse inaccessible (« Zinzolins et Nacarats ») . Oui, décidément, on trouve de tout dans Le Jardin dans l’île. Et surtout la certitude que Georges-Olivier Châteaureynaud est décidément un très grand écrivain, probablement jamais aussi à l’aise que dans la miniature. Un immense petit recueil. » Librairie Charybde — Paris
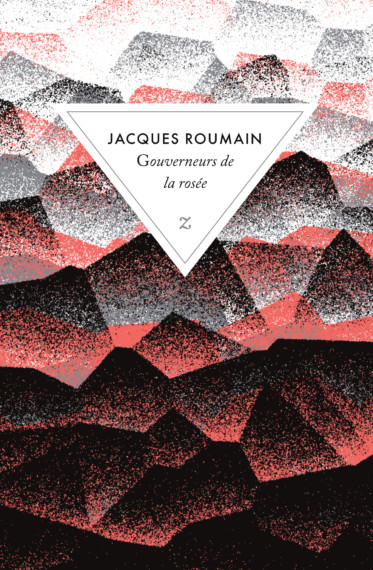 Gouverneurs de la rosée
Gouverneurs de la rosée« Publié en 1944 dans une relative indifférence, quelques mois avant la mort de son auteur, à 37 ans, réédité il y a quelques mois par Zulma après avoir été introuvable pendant des années, GOUVERNEURS DE LA ROSÉE, le troisième roman de l’activiste infatigable (en particulier contre la féroce occupation américaine des années 1915-1934) Jacques Roumain, est devenu depuis un grand classique de la littérature haïtienne moderne. Sous la plume du fondateur du Parti Communiste haïtien, en 1934, des personnages et une histoire prennent rapidement forme et se donnent rapidement les moyens d’accéder à un statut quasi-mythique. Lorsque le jeune Manuel revient de Cuba, où il a passé quinze ans comme ouvrier agricole dans les plantations de sucre, et participé de près à l’éveil d’une conscience socio-politique chez les prolétaires de la plus grande île caraïbe, il découvre son village natal haïtien au bord du gouffre, terrassé à la fois par une terrible sécheresse qui, ruinant les cultures vivrières des paysans pauvres, les met à la merci des riches marchands, qui rachètent leurs lopins à vil prix, et de leurs cohortes d’intermédiaires et fonctionnaires corrompus, qui les saignent de prêts usuraires et de tracasseries arbitraires, et par une sombre vendetta qui divise les forces vives des travailleurs de la terre, déjà amoindries, en deux clans apparemment irréconciliables. Il faudra toute l’abnégation de Manuel, arpentant inlassablement les mornes et les ravines à la recherche d’une source, et tout son amour partagé pour Annaïse, belle jeune fille du clan d’en face et complice de son rêve d’unité et de liberté, pour que, peut-être, les choses changent… En forme de fable, dans une langue magnifique où les dialogues font mouche et tapent fort, où les personnages ne sont jamais caricaturaux, où les descriptions, pourtant tout en retenue, font vivre la beauté, où transparaît comme le souffle d’un Giono qui aurait disposé d’une conscience socio-politique, un très grand roman. » Librairie Charybde — Paris
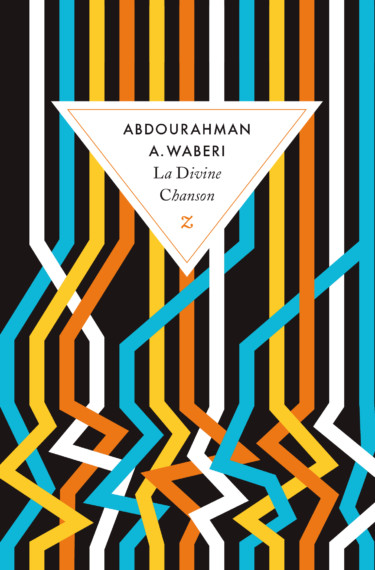 La Divine Chanson« Écoutez la grande et belle histoire de la légende vivante que fut Sammy Kamau-Williams ! Une histoire contée par Paris, étrange chat aux sept vies et multiples propriétaires et qui accompagna les dernières années de celui qui fut poète, chanteur de soul/jazz, acteur de lutte pour les droits des Afro-américains et tant d’autres choses encore. Mais qui fut aussi un homme poursuivit par ces démons, rongé par la drogue et dont chaque renaissance artistique tenait du miracle… Si Abdourahman Waberi n’utilise pas ici directement le nom de Gil Scott-Heron et le recouvre d’un pseudonyme transparent, c’est pour mieux clamer sa volonté de rester dans les territoires de la fiction. Sa Divine Chanson parvient miraculeusement à concilier une totale subjectivité de point de vue avec un grand respect de la véritable biographie de l’artiste (insistant notamment sur la place importante que les femmes ont tenue dans sa vie). Et si son étonnant narrateur emprunte parfois de sinueux chemins de traverse, c’est pour mieux revenir sur la lutte des Noirs pour leurs droits civiques, égratigner d’un coup de patte le “règne” de Michael Bloomberg à New York ou évoquer la trajectoire étonnante du père de Gil Scott-Heron…
La Divine Chanson« Écoutez la grande et belle histoire de la légende vivante que fut Sammy Kamau-Williams ! Une histoire contée par Paris, étrange chat aux sept vies et multiples propriétaires et qui accompagna les dernières années de celui qui fut poète, chanteur de soul/jazz, acteur de lutte pour les droits des Afro-américains et tant d’autres choses encore. Mais qui fut aussi un homme poursuivit par ces démons, rongé par la drogue et dont chaque renaissance artistique tenait du miracle… Si Abdourahman Waberi n’utilise pas ici directement le nom de Gil Scott-Heron et le recouvre d’un pseudonyme transparent, c’est pour mieux clamer sa volonté de rester dans les territoires de la fiction. Sa Divine Chanson parvient miraculeusement à concilier une totale subjectivité de point de vue avec un grand respect de la véritable biographie de l’artiste (insistant notamment sur la place importante que les femmes ont tenue dans sa vie). Et si son étonnant narrateur emprunte parfois de sinueux chemins de traverse, c’est pour mieux revenir sur la lutte des Noirs pour leurs droits civiques, égratigner d’un coup de patte le “règne” de Michael Bloomberg à New York ou évoquer la trajectoire étonnante du père de Gil Scott-Heron…
Le tout dessine une mosaïque qui parvient à rendre le charisme, l’aura propre aux artistes hors du commun (magnifiques passages évoquant les ambiances des derniers concerts) tout autant qu’à réinscrire la trajectoire d’un homme intègre et intransigeant dans le contexte d’une époque.
Un roman superbe qui donne une furieuse envie de réécouter d’une traite toute la discographie du grand Gil. » Librairie Charybde — Paris
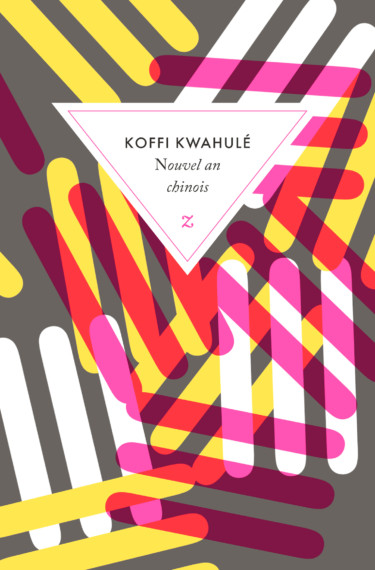 Nouvel an chinois« Le troisième roman du dramaturge ivoirien Koffi Kwahulé montre avec peut-être encore davantage de vigueur poétique que l’impressionnant MONSIEUR KI (2010) à quel point l’auteur excelle à créer de toutes pièces des univers à cheval sur la France et l’Afrique, univers frontaliers volontiers inquiétants, par la ruse forcenée avec laquelle ils défamiliarisent des éléments pourtant normalement paisiblement connus du lecteur. (...) Huis clos paradoxal construit avec minutie et poésie par Koffi Kwahulé, NOUVEL AN CHINOIS tient tout entier dans les tempétueuses vagues sous un crâne adolescent, celui du branleur (au sens propre du terme) Ézéchiel. (...) Peut-il porter sur ses frêles épaules et sur son cerveau, ultra-performant mais hanté par les malheurs familiaux, lucide mais prompt à mêler torrentueusement le fantasme et la réalité, le poids du quartier Saint-Ambroise ? Peut-il réellement brandir, seul ou presque, le drapeau du “vivre ensemble” confronté à la haine et à la folie racistes ? C’est tout l’art de Koffi Kwahulé de nous proposer un cheminement poétique, à la fois terriblement enjoué et réellement glaçant, au milieu de ce questionnement, alors que le hasard des calendriers de publication propose NOUVEL AN CHINOIS quelques semaines seulement après les tueries parisiennes des 7, 8 et 9 janvier 2015, déchaînement de haine et de stupidité sommairement maquillé en ferveur religieuse et identitaire. » Librairie Charybde — Paris
Nouvel an chinois« Le troisième roman du dramaturge ivoirien Koffi Kwahulé montre avec peut-être encore davantage de vigueur poétique que l’impressionnant MONSIEUR KI (2010) à quel point l’auteur excelle à créer de toutes pièces des univers à cheval sur la France et l’Afrique, univers frontaliers volontiers inquiétants, par la ruse forcenée avec laquelle ils défamiliarisent des éléments pourtant normalement paisiblement connus du lecteur. (...) Huis clos paradoxal construit avec minutie et poésie par Koffi Kwahulé, NOUVEL AN CHINOIS tient tout entier dans les tempétueuses vagues sous un crâne adolescent, celui du branleur (au sens propre du terme) Ézéchiel. (...) Peut-il porter sur ses frêles épaules et sur son cerveau, ultra-performant mais hanté par les malheurs familiaux, lucide mais prompt à mêler torrentueusement le fantasme et la réalité, le poids du quartier Saint-Ambroise ? Peut-il réellement brandir, seul ou presque, le drapeau du “vivre ensemble” confronté à la haine et à la folie racistes ? C’est tout l’art de Koffi Kwahulé de nous proposer un cheminement poétique, à la fois terriblement enjoué et réellement glaçant, au milieu de ce questionnement, alors que le hasard des calendriers de publication propose NOUVEL AN CHINOIS quelques semaines seulement après les tueries parisiennes des 7, 8 et 9 janvier 2015, déchaînement de haine et de stupidité sommairement maquillé en ferveur religieuse et identitaire. » Librairie Charybde — Paris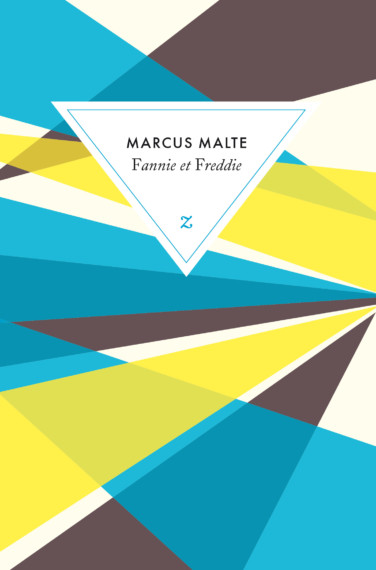 Fannie et Freddie« À l’encre noire et sur deux continents, le destin d’anonymes broyés par les tourmentes de la désindustrialisation et de la crise des subprimes. Personnage central du récit éponyme, Fannie semble d’entrée de jeu légèrement inquiétante, sans doute à cause de cette raideur apparente du buste et du cou dont elle dissimule habilement la cause sous sa frange, un œil de verre. Cette raideur lui vaut le surnom de Minerve. « Déesse de la sagesse et de la fureur guerrière », Fannie se fait le bras armé d’une vengeance démente et meurtrière en réponse à la folie économique, une implacable descente aux enfers depuis le parking d’un immeuble de bureaux cossu de New-York jusqu’à Bethlehem en Pennsylvanie, une ancienne ville sidérurgique doublement sinistrée par la fermeture des hauts-fourneaux et la crise de 2008. Ces deux mondes totalement étanches, même si l’un se nourrit de l’exploitation de l’autre, entrent en collision brutale dans cette novella à l’écriture nerveuse, huis-clos éprouvant quoiqu’assez attendu. Empreinte de tristesse, plus touchante et moins folle, la deuxième nouvelle, « Ceux qui construisent des bateaux ne les prennent pas », se déroule dans l’ombre des grues rouillées des chantiers navals de La Seyne-sur-Mer, ville de résidence de Marcus Malte. Ingmar Perhsson, inspecteur de police rongé par les remords, cherche à élucider la mort de son ami d’enfance tué d’un coup de feu sur la plage vingt-sept ans plus tôt. Convaincu qu’il ne s’agissait pas d’un accident mais bien d’un meurtre, Ingmar rumine les passés envolés de la ville et de son meilleur ami, tout en arpentant la plage des Sablettes, le crâne vrillé par des migraines qui le ramènent à sa tentative de rédemption, toujours inachevée. » Librairie Charybde — Paris
Fannie et Freddie« À l’encre noire et sur deux continents, le destin d’anonymes broyés par les tourmentes de la désindustrialisation et de la crise des subprimes. Personnage central du récit éponyme, Fannie semble d’entrée de jeu légèrement inquiétante, sans doute à cause de cette raideur apparente du buste et du cou dont elle dissimule habilement la cause sous sa frange, un œil de verre. Cette raideur lui vaut le surnom de Minerve. « Déesse de la sagesse et de la fureur guerrière », Fannie se fait le bras armé d’une vengeance démente et meurtrière en réponse à la folie économique, une implacable descente aux enfers depuis le parking d’un immeuble de bureaux cossu de New-York jusqu’à Bethlehem en Pennsylvanie, une ancienne ville sidérurgique doublement sinistrée par la fermeture des hauts-fourneaux et la crise de 2008. Ces deux mondes totalement étanches, même si l’un se nourrit de l’exploitation de l’autre, entrent en collision brutale dans cette novella à l’écriture nerveuse, huis-clos éprouvant quoiqu’assez attendu. Empreinte de tristesse, plus touchante et moins folle, la deuxième nouvelle, « Ceux qui construisent des bateaux ne les prennent pas », se déroule dans l’ombre des grues rouillées des chantiers navals de La Seyne-sur-Mer, ville de résidence de Marcus Malte. Ingmar Perhsson, inspecteur de police rongé par les remords, cherche à élucider la mort de son ami d’enfance tué d’un coup de feu sur la plage vingt-sept ans plus tôt. Convaincu qu’il ne s’agissait pas d’un accident mais bien d’un meurtre, Ingmar rumine les passés envolés de la ville et de son meilleur ami, tout en arpentant la plage des Sablettes, le crâne vrillé par des migraines qui le ramènent à sa tentative de rédemption, toujours inachevée. » Librairie Charybde — Paris